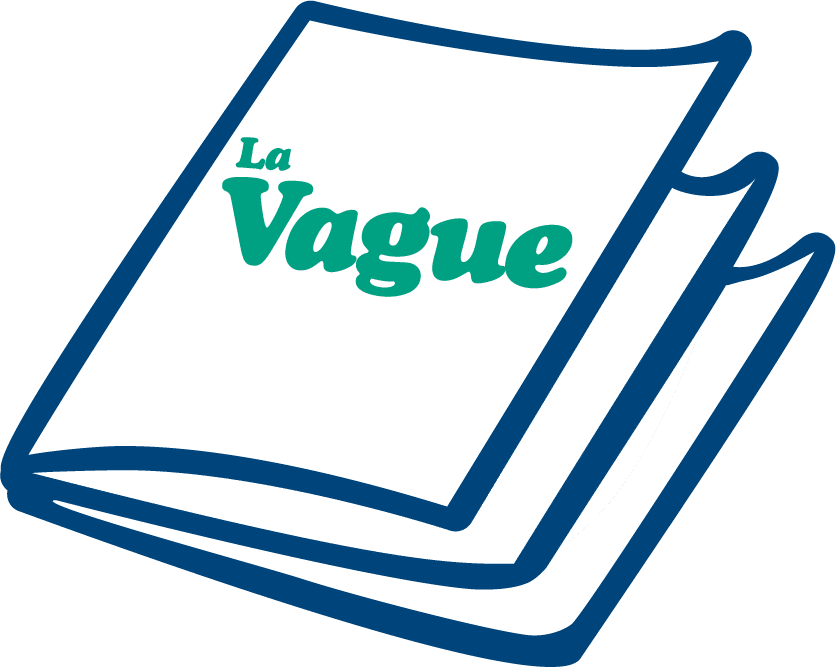Sommaire
- L'humanitaire au cœur de l'entreprise : enjeux & opportunités, retours d'expérience !
- Congrès International A3P 2018 : restitution des messages clés de la table ronde sur la révision de l'Annexe 1.
- Impact of Annex 1 revision on new vial filling line at Sanofi Pasteur Marcy-l'Étoile.
- Quantitative evaluation of microorganisms recovery from surfaces using contact plates.
- Investigation by molecular method of potentially non-compliant aseptic process simulation-media fill test (APS-MFT) and sterility test.
- Aseptic Processing Overview.
- L'industrie pharmaceutique : renforcer la culture de la qualité.
- Sauvegarde, réplication et archivage... Quelles mesures prendre pour préserver l'intégrité de vos données ?
Lors du 30ème Congrès International A3P à Biarritz (13-15 novembre 2018), une table ronde a été organisée sur le thème de l’Annexe 1 (Manufacture of Sterile Medicinal Products). Cette table ronde, animée par des membres du GIC A3P Annexe 1, était l’occasion d’échanger avec les participants sur un certain nombre de sujets ayant suscité un intérêt particulier des industriels pendant la phase de consultation publique (20 décembre 2017- 20 mars 2018) après publication du draft par l’EMA le 20 décembre 2017.

L’intérêt pour cette table ronde était aussi grandement motivé par la présence d’Andrew Hopkins, senior inspecteur MHRA et leader du groupe de travail EMA/PICS/WHO (IWG) en charge de la révision de l’Annexe 1.
Afin d’initier les discussions, les membres du GIC A3P Annexe 1 (Sophie Amadio /Lilly, Julien Triquet/GSK, Eric Hurtubise/Laboratoires Théa et Marc Besson/MB-GMP Compliance et leader du GIC A3P Annexe 1) ont préparé une série de questions autour de 5 thèmes représentatifs des préoccupations partagées par les industriels pendant la phase de consultation publique.
1. Etat d’avancement du processus de révision de l’Annexe 1
Préalablement aux échanges, Andrew Hopkins a donné des informations sur l’avancement du processus de révision et les prochaines étapes devant conduire à la publication de la nouvelle version de l’Annexe 1.
6 213 lignes de commentaires reçues de 140 entités différentes (A3P, PDA, PHSS, ISPE, LEEM, …) ont été revues individuellement par M. Hopkins et ont donné lieu à une série de commentaires et propositions d’actions pour l’IWG. Le draft de l’Annexe 1 a été révisé en tenant compte des commentaires les plus pertinents et renvoyé à l’IWG le 19 octobre 2018, puis retourné à Andrew Hopkins le 25 novembre pour transmission à l’EMA le 5 décembre. L’objectif de l’EMA, malgré les impacts organisationnels liés au Brexit, était de publier la version finale de l’Annexe 1 fin 2018.
2. Thèmes et questions abordés lors de la table ronde
a/ Encadrement de l’évolution des pratiques promotionnelles des produits sous peine de sanctions financières
La “stratégie globale du contrôle des contaminations (particulaire, microbiologique, pyrogène)” est un concept fondamental largement développé dans la révision de l’Annexe 1. Le GIC A3P Annexe 1 a souhaité apporter des clarifications sur la mise en œuvre de ce concept sur les sites industriels et les attentes des inspecteurs sur la consolidation des informations dans un document de synthèse.
Question GIC A3P Annexe 1
“CCs is mentioned 16 times in the update and clearly appears as a new key requirement. The new Annex 1 provides a detailed list of elements expected to be covered within a CCS. Most sites will already have many of the elements of a CCS as described by the Annex 1 but they may not be collated through a single source as appears to be the intent of this requirement.
- What would inspectors expect as a minimum acceptable standard document to meet the Annex 1 requirements regarding the CCS?”
Réponse d’Andrew Hopkins
Les industriels ont déjà formalisé de nombreux documents répondant aux différents éléments constituant une CCS, mais beaucoup n’ont pas encore consolidé ces éléments selon une approche globale et “holistique”. Le concept de la CCS est d’amener les industriels à réfléchir sur la pertinence de leurs actions telles que la localisation des boites exposées pour le contrôle de l’environnement, le scénario de leurs Media Fill Tests, la conception des locaux et de leurs procédés… un peu comme la relation entre les résultats des essais cliniques et la détermination des spécifications produits. Le développement d’une CCS doit conduire les industriels à avoir une connaissance détaillée de tous les éléments (locaux, procédés, équipements, composants, pratiques …) pouvant induire des risques microbiologiques et particulaires sur l’environnement et les produits, et démontrer comment ces risques sont éliminés ou maitrisés et quels sont les moyens de contrôle des conséquences de ces risques. Il n’est pas nécessaire d’avoir un document unique regroupant l’ensemble de ces mesures et justifications si elles sont déjà documentées de façon individuelle, mais il devrait exister un document de synthèse permettant de démontrer que chaque site a une connaissance approfondie des process et des risques. Ce document de synthèse permettrait de faire le lien entre les différentes actions et moyens de mesures en place par l’industriel.
Il faut rappeler que le concept de CCS n’est pas nouveau car il apparait déjà depuis de nombreuses années dans le chapitre 5 des BPF, mais un focus avait alors peut-être été réalisé sur la notion de contamination chimique, omettant ainsi de s’intéresser à la notion de contamination microbiologique pourtant déjà abordée dans ce chapitre.
b/ Quality Risk Management (QRM)
Le concept de QRM est aussi largement développé dans le draft de l’Annexe 1 mais pourrait entrainer certaines interprétations de la part des industriels et des inspecteurs quant à l’application et l’étendue de ce concept. Le GIC A3P Annexe 1 a souhaité aborder des exemples concrets pour lesquels les principes des QRM pourraient être appliqués.
Question GIC A3P Annexe 1
The draft of Annex 1 appears to be very detailed and prescriptive for some expectations but at the same time largely promotes the use of QRM principles. In addition, some sites could face limitations by design to implement some of the Annex 1 requirements.
- Could we have some examples where Annex 1 requirements are mandatory and some examples where alternative approaches supported by sound and scientific rationale may be acceptable?
- Would EMA encourage sites to pro-actively discuss alternative approaches with regulators before submission/implementation?
Réponse d’Andrew Hopkins
Si l’on comprenait vraiment le concept des QRM (industriels et inspecteurs), l’Annexe 1 pourrait être résumée comme suit :
“Design the processes, procedures and facilities not to contaminate the product. Design the monitoring system to detect any deleterious trend and or failure. Keep reviewing and developing as new information about your processes, procedures and designs comes to light. Keep developing as you become aware of new technological advances”.
Mais il doit être rappelé que l’Annexe 1 est écrite pour différents types de produits, de fabricants, pour beaucoup de pays dans le monde avec des compréhensions diverses des GMP et par conséquent le document doit être suffisamment prescriptif.
Un exemple pour lequel il ne devrait pas y avoir de flexibilité : si vous trouvez plus d’une CFU dans votre environnement grade A, il y a problème quelles que soient vos justifications scientifiques ! J’ai lu des commentaires pendant la consultation publique qui suggéraient que si les micro-organismes identifiés n’étaient pas pathogènes, ce n’était pas un problème ! Certaines exigences doivent rester obligatoires !
Les inspecteurs ont aussi beaucoup d’expériences et les GMP ont été écrites sur la base de mauvaises pratiques et de leurs conséquences. Lorsque des limites obligatoires sont précisées, elles s’appuient sur des historiques de problèmes avérés.
Un autre exemple : dans le draft il est écrit que les zones propres doivent être qualifiées tous les 6 mois mais en fait, ce que nous voulions exiger, est que l’intégrité des filtres HEPA des zones propres soit vérifiée tous les 6 mois. Ceci sera rectifié dans la version révisée. Devrait-il y avoir une discussion autour de cette fréquence ? Probablement non. Une fréquence de 6 mois est déjà relativement confortable. La raison pour laquelle je dis cela est un exemple récent d’un site qui en décembre dernier (2017) a contacté le MHRA pour signaler que 3 filtres HEPA sur 4 de sa classe A étaient non intègres. Une évaluation du risque a été conduite avec l’industriel et la conclusion était que tous les produits étaient critiques, qu’aucun lot ne pouvait être rappelé sans rupture de stock, et que la production ne pouvait s’arrêter ! Nous étions donc dans une situation où l’industriel et l’agence ont dû libérer des produits à risque. On ne pouvait pas s’appuyer sur les résultats des contrôles d’environnement, et nous avions 6 mois de production avec des lots à risque. Une fois le problème réglé, de nouveaux lots ont été produits afin de substituer au fur et à mesure les lots à risque sur le marché. En juin cette année, l’industriel nous a fait part de nouveaux problèmes d’intégrité des filtres HEPA de leurs zones propres avec 11% des filtres en grade A défectueux, 27 % en grade B et environ 50 % en grade C. En conclusion, vouloir étendre la fréquence de tests des filtres HEPA à 12 mois semble irresponsable, tout du moins pour les zones les plus critiques.
Les inspecteurs ont bien d’autres exemples de mauvaises expériences et cela explique des exigences parfois contraignantes.
Le point fondamental avec les QRM est de démontrer une connaissance approfondie de tous les éléments du process, et ceci au niveau même de l’atelier impliquant les opérateurs. Si vous envisagez des changements non classiques, innovants, il est important de rencontrer très rapidement vos interlocuteurs au sein des agences. N’attendez pas la soumission du dossier, ni la première inspection. Beaucoup d’agences (MHRA, EMA, FDA, …) ont des services spécifiques en charge de la revue des changements et innovations et on doit avoir cette discussion scientifique bien avant la mise en place du projet industriel. Le dialogue doit changer entre industriels et agences car certains industriels sont encore “frileux” à l’idée d’évoquer innovations ou projets avec les agences. Si l’on veut mieux promouvoir l’application des QRM, l’objectif est aussi d’ “éduquer” les inspecteurs sur les évolutions technologiques car s’ils ne les connaissent pas, ils peuvent être plus conservateurs.
c/ Zones propres conventionnelles vs Technologies Barrières
L’utilisation des technologies barrières permettant d’éloigner l’opérateur de la zone critique et du produit et donc de renforcer significativement le niveau d’assurance de stérilité du process devient une exigence de plus en plus évidente. Le GIC A3P Annexe 1 a souhaité clarifier quels pouvaient être les impacts GMP/réglementaires pour les nombreux sites utilisant encore des zones propres conventionnelles.
Question GIC A3P Annexe 1
The development of Barrier Technologies (RABS and Isolators) is largely promoted to enhance sterility assurance for aseptic processes but there are still a number of sites operating with conventional clean rooms.
- Would inspectors expect dedicated/enhanced risk assessments and procedures to maintain confidence with the level of Sterility Assurance provided by such facilities?
- In the future would EMA continue to accept submission dossiers supporting the use of conventional clean rooms for aseptic processes?
Réponse d’Andrew Hopkins
Tout d’abord l’exigence pour les industriels de toujours rechercher la mise à niveau de leurs installations par rapport aux nouvelles technologies n’est pas nouvelle puisqu’elle apparait dans le chapitre 1 des BPF depuis 2013 ou peut-être même avant.
L’utilisation des isolateurs serait-elle la seule réponse ? Certainement non ! Car de nombreux procédés ne sont pas compatibles avec l’utilisation d’isolateurs, par exemple lorsque vous avez des procédés de formulation très manuels ou des tailles de lots très petites, voire une unité … Le principe clé est d’éloigner l’opérateur de la zone critique et du produit que ce soit par l’utilisation de flux d’air adaptés, de RABS, d’isolateurs, de système clos … Pour nous inspecteurs, imposer l’utilisation spécifique d’isolateurs ou de RABS serait une erreur car nous devons aussi permettre l’émergence d’innovations tout en gardant en tête le principe clé.
Lors de la consultation publique, nous avons eu une question concernant une installation de conception ancienne qui procurait néanmoins de bons résultats environnementaux ; pouvons-nous nous maintenir cette installation ? La réponse est certainement non, car l’industriel doit évoluer vers des technologies plus modernes. Ce type d’installation ancienne est évidemment à risque. L’utilisation des QRM doit d’abord conduire à une bonne qualité de conception des locaux, des procédés, des procédures et ensuite, concevoir un programme de contrôle environnemental adapté. N’utilisez pas le contrôle environnemental pour justifier des mauvaises conceptions ou pratiques inadaptées.
Concernant la soumission de dossiers avec des zones propres conventionnelles, tout d’abord il faut préciser que la conception des installations n’est pas un point revu lors de l’évaluation du dossier par le “reviewer” mais plutôt une question relative aux GMP. Ainsi, même si votre dossier est accepté, vous pouvez avoir un refus de certificat GMP pendant l’inspection. Je pense qu’il sera de plus en plus difficile d’accepter des installations de conception ancienne, tout simplement parce que l’industriel ne répondra pas à l’exigence de mise à niveau des installations par rapport aux nouvelles technologies. Pouvons-nous tout changer immédiatement ? Certainement non, car il y a encore de nombreuses installations de ce type dans le monde.
Question complémentaire sur les principes d’harmonisation entre agences (reviewers et inspecteurs)
- Comment se traduit à ce jour la volonté d’harmonisation entre les agences notamment lorsque nous soumettons un dossier avec plusieurs reviewers/rapporteurs qui peuvent ne pas être d’accord entre eux ?
Réponse Andrew Hopkins
Au fur et à mesure de l’avancement du draft, le PICS s’engage à former les différents inspecteurs de façon à limiter les interprétations. Mais cette formation (éducation) se fait aussi à travers des instances comme A3P, PHSS, PDA qui ont un rôle important pour échanger hors contexte réglementaire sur des thématiques controversées ou des innovations.
d/ Test d’intégrité du filtre produit stérilisé avant utilisation (PUPSIT)
Le PUPSIT (Pre Use Post Sterilisation Integrity Test) a fait l’objet de nombreux commentaires lors de la consultation publique et reste un sujet controversé au sein des industriels par rapport aux exigences de l’Annexe 1. Le GIC Annexe 1 a souhaité faire clarifier la position de l’IWG et notamment savoir si une approche QRM est possible dans des cas spécifiques pouvant induire un risque produit.
Question GIC A3P Annexe 1
The new Annex 1 still considers that PUPSIT must be implemented but for some existing installations manipulations downstream the filter may be at risk for the product.
- Would inspectors consider that PUPSIT is mandatory for all lines and therefore line modifications/upgrades must be carried out or would inspectors consider as acceptable if a documented risk analysis is provided?
- If a RA is acceptable which risk-related elements should be covered in the RA?
Réponse d’Andrew Hopkins
Le PUPSIT a effectivement fait l’objet de nombreux commentaires mais cette exigence existe déjà dans la version actuelle (2008) et donc la première question est pourquoi les industriels ne l’ont pas déjà mis en place !
De mon point de vue personnel (ne reflète pas le point de vue de l’EMA) je pense qu’il doit y avoir des opportunités de discussion. Nous savons tous que les filtres peuvent être endommagés ou colmatés : cela répond à des lois physiques. Une analyse de risques acceptable pourrait être basée sur des considérations intégrant des contrôles appropriés du fournisseur de filtre (pas uniquement les contrôles “standards”), du transport, de la stérilisation, si notamment elle est sous traitée, associés à une bonne connaissance des caractéristiques du produit et du procédé de filtration. Par exemple, si nous avons un process avec de multiples filtres clarifiants avant le filtre produit, il y a peu de chance que la solution à filtrer comporte des particules et donc une probabilité faible de colmater le filtre.
Autre exemple, la nature et les caractéristiques de la solution à filtrer sont des éléments de décision importants. Notamment si nous filtrons de l’EPPI, combien de litres devrons-nous filtrer avant de colmater le filtre stérilisant ? Certainement plus que la capacité de production de votre unité de production. Ces exemples sont des bons points de départ et il y a des ouvertures possibles pour la discussion, mais vous devez démontrer votre connaissance parfaite de votre procédé et de votre produit. J’ai proposé cette approche d’Analyse de Risques (AR) à l’IWG mais certains la refusent encore quand d’autres ne veulent plus entendre parler du PUPSIT ! À ce jour, nous ne savons pas ce que sera la position finale dans la nouvelle version de l’Annexe 1.
Par contre, ce que nous ne voulons pas, c’est l’utilisation de l’AR pour justifier que l’on ne veut pas mettre en place le PUPSIT. Si vous engagez cette AR, vous ne devez pas connaitre la conclusion avant de débuter l’analyse.
Question des participants
- Pouvez-vous commenter l’initiative de la PDA sur des essais de colmatage en fonction de la nature des solutions et de facteurs spécifiques de filtration ?
Réponse d’Andrew Hopkins
En effet, la PDA a initié un certain nombre d’études concernant le PUPSIT (“PDA/BPOG Memorandum of Understanding, Filter manufacturers joint statement, Filter blocking trial initiative”) et notamment un plan d’expérience consistant à simuler des tests avec plusieurs types de solutions afin de collecter des informations scientifiques sur les paramètres de colmatage des filtres (quand, quelle biocharge nécessaire, quel niveau de perte d’intégrité peut être masqué par un colmatage …). Le protocole a été revu par l’IWG. Voici vraiment un bon exemple sur la façon d’introduire le QRM et une collaboration entre agences et industrie.
e/ Robustesse de la décontamination des surfaces par le Peroxyde d’Hydrogène vaporisé (VH2O2)
La publication, le 20 avril 2018 sur le site du MHRA, d’un blog mettant en cause la robustesse du VH2O2 utilisé pour la décontamination des surfaces indirectes critiques (VHP (Vapour Hydrogen Peroxide) Fragility) a suscité de nombreux commentaires au sein de l’industrie et des craintes sur le maintien de ce type de décontamination pour les installations d’isolateurs existantes. Cette position spécifique du MHRA ne reflète cependant pas la vision de l’IWG et ne sera pas reprise dans l’Annexe 1. Le GIC A3P Annexe 1 a souhaité relancer les discussions notamment pour clarifier les éventuels impacts pour les isolateurs en opération pour lesquels un démontage/stérilisation à la vapeur/remontage des bols bouchons, convoyeurs, rampes, … peuvent s’avérer à risque voire impossible de par la conception des équipements.
Question GIC A3P Annexe 1
MHRA has recently challenged the efficacy of Vaporized Hydrogen Peroxide for the decontamination of Indirect product contact parts (Stopper bowls, hoppers, conveyers..) and suggests that such parts be sterilized in autoclaves and then be aseptically set up once the isolator is decontaminated. Many existing isolators are not designed to allow easy dismantling of indirect product contact parts and these manipulations may generate new risks (ie loss of glove integrity due to additional manipulations…)
- Will the revised Annex 1 include clarification on requirements for the use of decontaminating/sterilizing agents such as VH2O2?
- Would inspectors accept a risk based approach for existing isolator lines to demonstrate that all measures are in place to ensure VH2O2 robustness?
- Is this position on VH2O2 applicable to conventional clean rooms where stopper bowls, hoppers and conveyors are decontaminated in place?
Réponse Andrew Hopkins
J’ai écrit ce blog sur le site du MHRA car j’ai observé beaucoup de problèmes sur la façon d’utiliser le VH2O2 par certains industriels et leur méconnaissance de la “fragilité” de cet agent de décontamination. Si le VH2O2 est utilisé dans des conditions maitrisées de température, humidité, durée, on peut atteindre une efficacité de 6 log de réduction mais il y a aussi beaucoup de contraintes liées à tous ces paramètres physiques et notamment la notion d’efficacité de pénétration. Et ce que nous voyons lors des inspections, c’est que les industriels ne comprennent pas ces contraintes.
Par exemple, j’ai inspecté un site où ils avaient un très bon procédé RABS décontaminé au VH2O2 et pour lequel ils utilisaient un flexible (utilisé pour inerter des poches de stockage) de 2 mètres de long. Selon l’industriel, ce flexible était “stérilisé” par le VH2O2 uniquement par contact passif. En aucun cas le VH2O2 ne peut diffuser “passivement” à travers un filtre et tout au long d’un flexible d’une telle longueur !
Un autre exemple avec un bol bouchons pour lequel la procédure de nettoyage consistait uniquement en un simple rinçage à l’EPPI sans aucune considération de l’élimination des éventuels résidus qui peuvent diminuer l’efficacité du VH2O2. La manipulation de ce bol bouchon en grade D avec un risque de contact des surfaces avec la peau et donc le risque de laisser des traces d’acides gras sur ces surfaces, peut entrainer des occlusions de microorganismes et donc empêcher le contact avec le VH2O2.
Enfin, la position très questionnable d’Indicateurs Biologiques (BIs) localisés à l’extérieur de guides de bouchons (et non à l’intérieur du rail) … de même le concept du nombre de BIs par position (3) sur la base d’une approche “statistique” qui permettrait d’accepter un cycle de décontamination avec un BI positif / 2 bis négatifs reste très controversé lui aussi …. Et dans tous ces cas, on parle de “stérilisation” de parties critiques en contact avec les composants primaires en contact avec le produit ! La connaissance et la compréhension des mécanismes d’action du VH2O2 et de ses limites sont nettement insuffisantes par les industriels.
Pour les installations actuelles, faire une AR pour justifier le maintien de mauvaises pratiques : NON ! Car nous ne voulons pas que ce type d’AR soit rapporté par l’industrie et justifie la poursuite de ces pratiques. Par contre, si un industriel a un procédé robuste avec une procédure de nettoyage renforcée (pas un simple rinçage), des pratiques de manipulations limitant la biocharge …. Il doit contacter son agence pour étudier au cas par cas le procédé et le compléter le cas échéant avant la prochaine inspection.
Il n’y aura pas de position spécifique sur la décontamination au VH2O2 dans l’Annexe 1 mais le concept est déjà précisé celui de la démonstration que chaque partie critique doit être en contact avec l’agent stérilisant.
Réaction du public
Nous travaillons depuis les années 1990 sur les isolateurs et nous connaissons la fragilité du VH2O2 que nous avons d’ailleurs déjà maintes fois évoquée avec le MHRA (ex MCA) ! 25 ans après, nous continuons à débattre sur le même sujet. Nous avons aussi connu des problèmes avec la stérilisation à la vapeur et nous avons mis plusieurs décades à mettre cette stérilisation sous contrôle par la maitrise de la qualité de la vapeur, la notion de vide, la conception des charges …. Donc merci de laisser du temps aux industriels pour maitriser le procédé VH2O2. Si nous appliquons les approches QRM de l’Annexe 1 pour ce procédé, les bénéfices sont largement supérieurs aux risques lorsque l’on produit des millions d’unités par procédé aseptique. Il faut noter aussi que votre “voix” fait écho au niveau réglementaire et que certains inspecteurs FDA appliquent déjà vos commentaires pendant les inspections. La façon dont vous exprimez votre opinion sur ce sujet peut créer quelques problèmes au sein de l’industrie pharmaceutique et il serait utile que vous ayez un discours plus “positif” pour que l’industrie soit motivée dans sa recherche de l’amélioration de cette technologie.
Réponse d’Andrew Hopkins
Il est vrai que nous avons eu beaucoup de décès à cause d’une mauvaise maitrise de la stérilisation à la vapeur et notamment au Royaume Uni. Je ne veux pas avoir la même situation avec le VH2O2 et si j’ai écrit ce blog, c’est aussi pour avoir ce genre de discussions et ne pas continuer à voir des flexibles de plusieurs mètres de long “stérilisés” au VH2O2. Des associations telles que PHSS, A3P rédigent des guides permettant de mieux comprendre ces procédés. Il faut aussi associer les fournisseurs pour que la discussion soit tripartite (Agence, industriels et fournisseurs). Concernant mon approche, si je n’avais pas communiqué de la sorte, nous n’aurions pas ce débat et j’ai reçu un certain nombre de commentaires arrogants mais les problèmes liés au VH2O2 sont mondiaux et pas limités uniquement à une région en particulier.
Complément de discussion par J. Drinkwater/ PHSS
Les éléments limitant l’efficacité du VH2O2 tels qu’ils ont été évoqués sont validés par le PHSS. Nous avons rédigé une recommandation pour l’utilisation du VH2O2 que nous avons partagée avec A3P et il apparait que jusqu’à présent, nous étions trop focalisés sur l’inactivation des BIs pour évaluer la performance du cycle de stérilisation VH2O2 (atteignant jusqu’à 12 log de réduction) sans nous soucier de l’état des surfaces à stériliser. Il faut donc considérer l’ensemble des facteurs physiques ayant un impact sur la robustesse du VH2O2 et pas uniquement l’inactivation de BIs.
Note Post table ronde concernant le VH2O2
En réponse aux questions soulevées par le blog d’ Andrew Hopkins publié sur le site MHRA, le PHSS a publié en décembre 2018 une note for Guidance N°1 intitulée : Assurance of Sterility for container closure in-direct product contact surfaces in Aseptic process filling. Role of vaporised hydrogen peroxide bio-decontamination in a contamination control strategy combining Sterilization + Bio-burden control + VHP/VH2O2. Ensuring sterility of indirect product contacting surfaces”.
Cette publication reprend les risques identifiés par Andrew Hopkins, clarifie les limites du procédé et suggère un plan d’actions pour renforcer la robustesse du procédé VH2O2 en s’appuyant notamment sur un renforcement :
- du nettoyage des parties d’équipements en contact avec les composants primaires,
- des pratiques d’habillage lors des interventions de démontage/montage de ces équipements,
- des moyens de maitrise et limitations de biocharge sur les équipements concernés.
La publication suggère une stérilisation des équipements à la vapeur propre hors ligne, leur protection en saches Tyvek© jusqu’à leur remontage dans les isolateurs dont le flux d’air unidirectionnel est maintenu opérationnel puis une décontamination des surfaces exposées au VH2O2.
3. Conclusions et prochaines étapes
Les échanges interactifs de cette table ronde ont permis de clarifier certaines interrogations des industriels et d’entrevoir notamment une approche moins directive sur le sujet du PUPSIT. Ces ouvertures seront-elles concrétisées dans la nouvelle version de l’Annexe 1 ? La réponse sera peut-être connue des industriels lors de la parution de cet article si la nouvelle version de l’Annexe 1 est officiellement publiée. Par ailleurs, selon Andrew Hopkins, un délai de 6 mois pourrait être accordé pour la mise en place des exigences à partir de la date de publication officielle mais ce délai pourrait être allongé pour certains sujets en concertation avec l’EMA, le PICS et WHO.