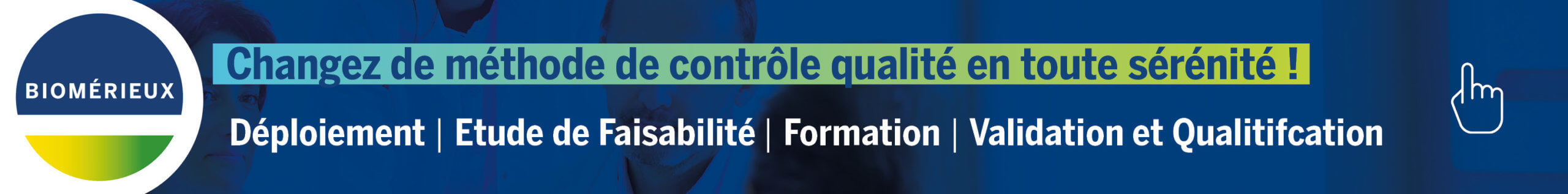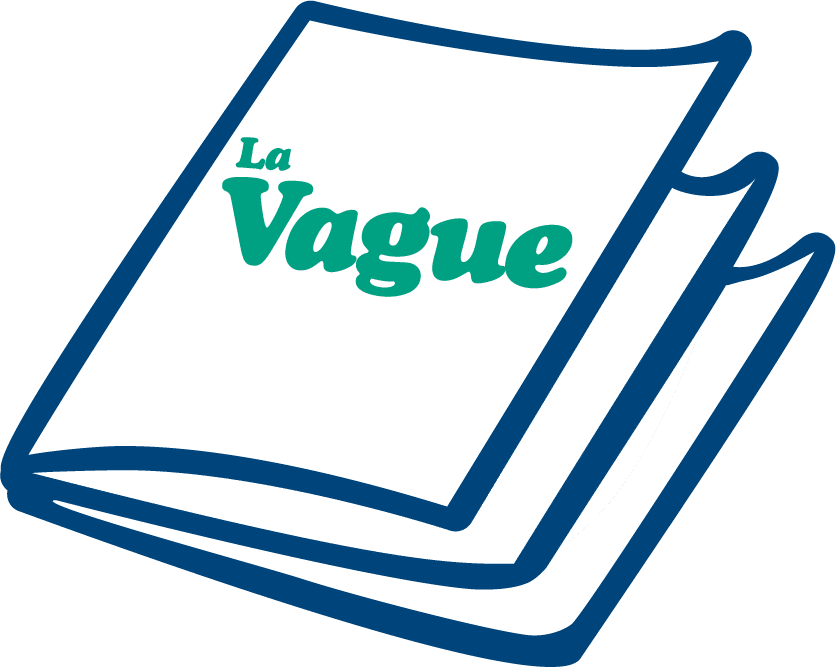Octobre 2024
La Vague n°83
EU GMP Annex 1 / Maitrise du risque patient ICH Q9(R1) / Digitalisation
Sommaire
- What does 21 CFR Part 11 mean in everyday online analytics?
- Digitalization in cleaning validation an overview of possibilities, challenges, and opportunities for savings?
- EU GMP Annexe 1. Mise en œuvre de la Stratégie de Contrôle de la Contamination
- Impact of the new Annex 1 on Sterile Filling
- The Challenges of Floor Cleaning & Sanitization
- Réduction énergétique des centrales de traitement d’air : comment adapter son monitoring environnemental ?
- USP <922> Water Activity: A Better Approach for Lyo Moisture Determination. Applications enabled by rapid non-destructive headspace moisture analysis of freeze-dried product
- Gestion durable de l'eau dans l'industrie pharmaceutique
- Rapid Testing for Cell & Gene Therapy Products: A Three-Level Approach Using an Automated Solid Phase Cytometry System
Réduction énergétique des centrales de traitement d’air : comment adapter son monitoring environnemental ?
Le réchauffement climatique est là, c’est un fait. De plus, les coûts de l’énergie ont explosé ces dernières années avec une augmentation de près de 78% des coûts pour l’électricité entre 2014 et 2024(1). De ce fait la diminution de la consommation énergétique devient un véritable enjeu écologique et économique pour les industries du secteur de la santé. D’autant plus que nos industries fabricantes sont très gourmandes en énergie : eau, gaz, électricité, ce sont de réels gros postes de consommations qu’il est possible d’optimiser !

Quand on pense réduction de la consommation des énergies, la réduction de l’eau est souvent au cœur de programme d’investissements mais, sur nos sites industriels, il est aussi possible de réduire drastiquement ses consommations d’électricité notamment en agissant sur les centrales de traitement de l’air qui alimentent nos salles propres.
1. Centrales de traitement d’air et consommation d’énergie
Les Centrales de Traitement de l’Air ou HVAC qui alimentent en air filtré nos salles propres et autres environnements maitrisés apparentés sont de grandes consommatrices d’énergie. Elles consomment de l’électricité bien évidemment pour filtrer l’air mais aussi pour le chauffer le refroidir et gérer son taux d’humidité. Selon une étude, EDF rapporte que 48% de la consommation d’une CTA contribuerait à sa ventilation (filtration et soufflage/reprise d’air), 40% à la production de froid et 12% au chauffage(2).
Avec l’augmentation des températures pendant les périodes printanières et estivales la part de consommation réservée au refroidissement de l’air pourrait encore augmenter, alors que les CTA vieillissantes du parc industriel sont en souffrance pendant les périodes de fortes chaleur. Selon des valeurs simulées présentées par un cabinet d’engineering spécialisé, une CTA alimentant une salle propre de 100m2 pourrait consommer entre 100 000 et plus de 300 000kWh/an selon les réglages effectués sur la machine(3). Soit un coût pour l’électricité pouvant aller de 20 000 à plus de 60 000€/an pour une salle propre de 100m2.
Depuis juin 2019 la réglementation internationale s’est emparée du sujet avec la parution de l’ISO 14 644-16 (2019) : Salles Propres et environnements maitrisés apparentés : efficacité énergétique dans les salles propres et les dispositifs séparatifs. La norme guide les utilisateurs dans la mise en place d’une démarche pour permettre la réduction des coûts de l’énergie et notamment pour les centrales de traitement de l’air.
2. Sources de surconsommations énergétiques
Dans une démarche de réduction des coûts de l’électricité il est fort utile de pouvoir être guidé et aidé. En effet les sources de surconsommations énergétiques sont nombreuses et variées et nécessitent parfois des connaissances techniques poussées pour identifier les optimisations possibles.
Les causes possibles peuvent résulter d’un défaut de design des locaux. En raison de ces défauts de design les industriels peuvent parfois être poussés à surcompenser par un soufflage plus important au niveau des CTA. Des réglages de pressions et/ou de TRH plus importants que nécessaires sont parfois mis en place pour compenser des faiblesses de conception.
De manière assez liée, des problèmes de conception de locaux mais aussi des défauts d’utilisation ou des dérives dans les procédures peuvent entrainer des problèmes de contaminations environnementales. Il est alors courant de voir les sites tenter de remédier à ces contaminations parfois incontrôlables par des réglages plus forts au niveau des débits de soufflage ou des TRH. Pour rappel, la réglementation et les différentes guidelines attendent ou conseillent un minimum de 10Pa de différentiel de pression entre deux salles adjacentes de classe différente. Dès lors, des pressions supérieures peuvent être nécessaires dans certains cas précis liés au procédé de fabrication (risque BSL >2, besoin de dépression/puit de pression, produit particulier…) mais la mise en pression supérieure ne devrait pas être justifiée par des défauts de structures compensés par ce biais. La surpression appliquée est nécessairement impactante pour la consommation d’énergie et constitue alors une piste de réduction énergétique non négligeable.
Au niveau de la conception initiale ou du revamping de CTA existantes d’autres thématiques sont sources de consommations inutiles :
Par exemple le surdimensionnement des filtres. Plus nombreux sont les filtres redondants ou consécutifs, plus la perte de charge est importante et plus la consommation est impactée. De même les filtres les plus fins sont les plus énergivores à cause des pertes de charge et du taux de soufflage qu’il faut appliquer pour les traverser. Il est donc nécessaire de s’assurer que le système de filtration envisagé est adapté aux locaux, au besoin réel et surtout révisé dans les cas de revamping des locaux.
De plus le choix de fonctionnement en système tout air neuf ou partiellement recyclé sera également impactant sur la consommation directe de la ventilation mais aussi sur les systèmes de gestion de la température et de l’hygrométrie. De l’air partiellement recyclé sera déjà ou presque à bonne température et à la bonne hygrométrie ce qui nécessitera moins d’énergie qu’un système tout air neuf. Les systèmes tout air neuf n’étant absolument pas nécessaires dans tous les cas de figure, il s’agira d’adapter le fonctionnement de sa CTA au réel besoin du site.
Enfin le levier d’action pouvant impacter grandement la consommation d’énergie d’une CTA se trouve sur les consignes de températures et d’hygrométrie. Bien entendu il s’agit de trouver le bon équilibre entre maitrise de la consommation d’énergie et maitrise de la contamination. Une température de consigne permettant de travailler dans de bonnes conditions doit être trouvée afin d’éviter les phénomènes de sudation excessifs du personnel. Cette température dépendra des conditions de travail et de l’habillement en place dans les locaux considérés.
Une température trop importante en plus d’être potentiellement plus favorable au développement des microorganismes déjà présents dans les locaux, risque d’entrainer un phénomène de sudation du personnel ayant pour conséquence une émission de particules plus importante et un risque de contamination par l’Homme accru.
La fourchette de température de travail idéale doit permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions sans accentuer le risque de contamination par l’Homme. Néanmoins une fois la température de travail idéale trouvée, un comparatif peut être fait avec les températures de consigne, pour les adapter au plus juste et ainsi réduire la consommation liée au chauffage ou au refroidissement de l’air. Ainsi la température de travail l’été peut différer de la température de travail l’hiver pour limiter le niveau de refroidissement en été et le niveau de chauffage en hiver.
De plus, le fait d’identifier les bonnes températures selon les conditions aura un impact sur le niveau d’hygrométrie dans les locaux. En effet une baisse de la température aura pour conséquence une augmentation de l’hygrométrie et inversement. Les bons réglages concomitants de température et d’hygrométrie permettront de réduire la consommation d’énergie au plus juste par rapport au besoin dans les locaux, tout en limitant le risque de prolifération microbienne.
A noter tout de même que l’ISO 14 644-16 indique qu’il est possible de laisser l’humidité fluctuer entre 30 et 70% lorsque l’exigence est uniquement liée à du confort opérateur. Néanmoins il est utile de rappeler que l’hygrométrie, tout comme la température, ayant un impact sur le taux de croissance des microorganismes (et notamment les microorganismes sporulés !) la valeur cible pourrait se situer autour ou en dessous de 60%. En approchant de 70% d’hygrométrie et plus, les contaminants fongiques et sporulés potentiellement présents dans les locaux risquent de devenir difficilement maitrisables.
3. Pistes de réduction énergétiques
En réponse à la surconsommation énergétique engendrée par des réglages de CTA inadaptés pour les raisons citées ci-dessus, il est possible de procéder différemment et de mettre en place des actions visant à réduire la consommation électrique des CTA.
Ainsi, si des réglages sont forcés volontairement à des fourchettes hautes engendrant une consommation d’énergie importante, il est possible de travailler sur les causes des problématiques de conception ou de maitrise de la contamination afin de revenir à des réglages plus classiques et surtout moins énergivores.
De manière générale les pressions des zones et les TRH peuvent être passés en revue et diminués si leur réglage en seuil haut n’est pas la résultante d’une nécessité technique. Les cascades de pressions peuvent être revues pour coller aux référentiels guides et les TRH peuvent être abaissés autour de 20 à 30 vol/h pour des zones de classe B ou plus (ou ISO6 ou plus).
L’ensemble des réglages adoptés doit bien évidemment permettre de tenir l’ensemble des spécifications attendues, et la nécessité de compenser certaines défaillances par des réglages plus importants peut permettre d’identifier une faiblesse de fonctionnement d’une CTA. Dans certains cas il sera peut-être judicieux de procéder à des changements de pièces voire au remplacement de la CTA afin de garantir des performances avec un niveau de consommation énergétique maitrisé.
L’ISO 14 644-16 propose deux autres pistes pour permettre de réduire la consommation électrique des CTA :
– Le niveau de brassage de l’air autrement dit le débit de soufflage et de reprise de l’air pourrait être abaissé en période d’inactivité dans la salle. Du fait de l’absence de personnel, le repos particulaire et microbiologique obtenus peut permettre de conserver les spécifications de la classe avec une aéraulique moins importante permettant de rentabiliser les périodes d’inactivité en matière de consommation énergétique.
– Enfin cette même logique appliquée aux salles donc dans des environnements à flux d’air turbulent peut être appliquée au niveau des flux laminaires où la norme indique que dans des conditions d’activité faible ou nulle, la vitesse peut être réduite à 0,2-0,3m/s au lieu de 0,36-0,54m/s.
4. Conséquences de ces adaptations sur le monitoring environnemental
Si un remplacement des CTA vieillissantes par d’autres plus performantes ou l’adaptation de design de certaines zones n’auront pas nécessairement d’impact direct sur le plan de monitoring environnemental, certains réglages visant directement à réduire le niveau de consommation énergétique des centrales de traitement de l’air peuvent nous amener à nous questionner sur l’impact de la maitrise de la contamination au sein des zones à atmosphères contrôlées.
Dès lors qu’une modification est susceptible d’impacter le type, la quantité ou bien la capacité de croissance des microorganismes dans une zone classée, alors le plan de surveillance environnemental doit s’adapter pour s’assurer de la bonne maitrise de la contamination dans la zone malgré les mesures prises. Ce type de modifications (réglages des CTA et impact sur le plan de monitoring environnemental) doit faire l’objet d’un encadrement dans le cadre d’un processus de maitrise du changement (change control).
Quelles que soient les actions de réduction de la consommation d’énergie entreprises, la qualité de l’épuration de l’air ou de la cinétique de décontamination peuvent être impactés. Dans ce cas il est nécessaire d’être capable d’évaluer l’impact de ce changement et surtout de suivre l’absence d’impact néfaste des actions mises en place, sur la maitrise microbiologique et particulaire de l’air. Nécessairement, des tests de qualification devront être réalisés pour s’assurer de la qualité de l’aéraulique dans la zone considérée, de la cinétique de la décontamination et de la qualité globale du brassage en place au travers de ces réglages.
En routine, il serait pertinent de s’assurer de la maitrise de la qualité particulaire de l’air au travers d’un nombre de prélèvements stratégiquement placés. Par exemple si le plan de surveillance environnemental de routine prévoit moins de prélèvements que le plan de qualification, une vérification accrue des points non surveillés en routine peut être pertinente pendant une période donnée après l’application des changements de paramètres.
L’impact des changements intervenus pouvant affecter la qualité de l’air soufflé, des points de surveillance particulaires supplémentaires peuvent être envisagés à proximité des bouches de soufflage et de reprise de l’air. De la même manière pour les flux laminaires l’absence d’impact d’une diminution de la vitesse devrait être évaluée au travers de prélèvements particulaires durant la phase de baisse de la vitesse. Tout comme pour les prélèvements particulaires, la qualité microbiologique de l’air doit être encadrée dans ce type de processus. La maitrise microbiologique de la zone pourrait potentiellement être affectée surtout au niveau de la qualité de l’air. De ce fait de la même manière que pour les prélèvements particulaires il serait judicieux d’adapter le plan de contrôle environnemental notamment au travers de prélèvements d’air plus nombreux et/ou sélectionnés aux points stratégiques pour visualiser une éventuelle dégradation de la qualité microbiologique de l’air. Dans ce cas on privilégiera plutôt les contrôles microbiologiques de l’air par aérobiocollection qui seront le reflet de la qualité de l’air brassé contrairement aux prélèvements d’air par sédimentation.
Sous un flux laminaire en fonctionnement à vitesse réduite les prélèvements d’air par sédimentation seront néanmoins suffisants pour s’assurer de la qualité microbiologique de l’air soufflé.
Enfin, même si le principal aspect potentiellement affecté est la qualité de l’air, les mesures prises et leurs conséquences (sudation éventuelle du personnel, sédimentation de contaminants…) peuvent tout de même affecter la maitrise globale de la contamination microbienne dans l’ensemble de la zone. Il ne serait donc pas inintéressant d’envisager le renforcement du plan de surveillance environnemental en réalisant une analyse de risque prenant en considération les changements opérés sur les CTA.
Cette réévaluation des risques pourrait permettre d’identifier des points de surveillance particuliers, constitués de points de prélèvements microbiologiques de l’air mais aussi des surfaces et qui pourraient être intégrés à un plan de surveillance renforcé pendant une période donnée, par exemple. De nouveaux points permanents pourraient également être intégrés au plan de routine déjà en place. Sur le plan quantitatif il est donc important d’être en mesure d’évaluer l’impact des solutions mises en œuvre. Néanmoins il ne faudra pas négliger l’impact d’une potentielle évolution sur la flore microbienne de la zone. Si des paramètres comme la température ou l’hygrométrie sont modifiés cela peut impacter assez fortement le type de contaminants prédominants dans la zone. Même si les sources de contamination restent les mêmes, les niveaux d’épuration de l’air ainsi que la capacité de croissance des microorganismes peut en être affectée.
Il s’agira donc de prévoir, si ce n’est déjà en place, un monitoring qualitatif des microorganismes retrouvés dans la zone et de s’assurer de l’absence d’une recrudescence de croissance des organismes fongiques et sporulés. Si la flore microbienne peut en effet être affectée, les sources de contamination n’ayant pas été modifiées, la répartition des microorganismes en termes de provenance ne devrait pas être modifiée.
Le plan de surveillance qualitatif post modifications sur les CTA, devrait prévoir en amont de la mise en place du changement, les remédiations en cas d’impact néfastes sur la maitrise de la contamination dans la zone.
5. Conclusion
Les CTA étant très énergivores et avec un parc Français conséquent, de nombreux sites pourraient être concernés par la possibilité de mettre en place des actions permettant d’optimiser leur consommation d’électricité par ces CTA. Si certaines actions peuvent sembler simples à mettre en place, d’autres peuvent nécessiter l’accompagnement de professionnels maitrisant parfaitement le fonctionnement de ces machines.
Toutefois, quelles que soient les adaptations réalisées, des impacts potentiels peuvent en résulter. Des impacts sur la maitrise de la contamination des zones qui peuvent se manifester tant quantitativement que qualitativement. L’adaptation du plan de surveillance environnementale est alors primordiale pour s’assurer du maintien de conditions permettant une bonne maitrise de la contamination, garantissant ainsi la réussite globale de l’action mise en œuvre pour réduire la consommation énergétique tout en maitrisant toujours au juste niveau la contamination de nos salles propres.
Partager l’article

Références
1. Evolution des prix de l’électricité sur 10 ans en France : https://www.otovo.fr/blog/le-solaire-et-vous/evolution-prix-electricite-10-ans/
2. Article l’usine nouvelle : https://www.usinenouvelle.com/article/efficacite-energetique-rendre-les-installations-plus-economes-en-energie.N1471642
3. Présentation ASPEC par Air Consult – 1er décembre 2016 – par Goossens Alix : https://www.aspec.fr/Data/ElFinder/s6/Base-documentaire/C-Performance-Energetique/8-Alix-Goossens-AIR-CONSULT-Colloque-ASPEC.pdf